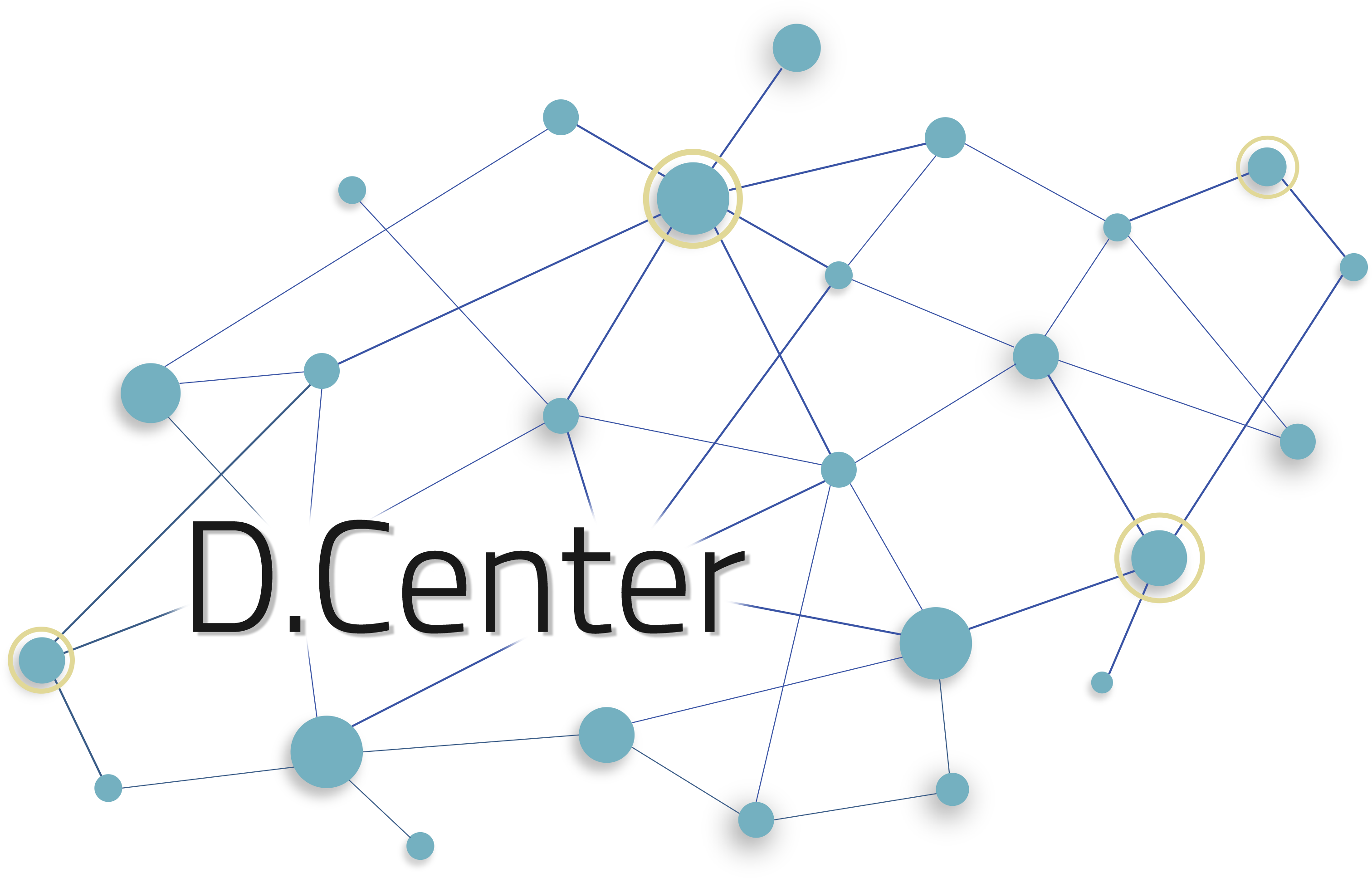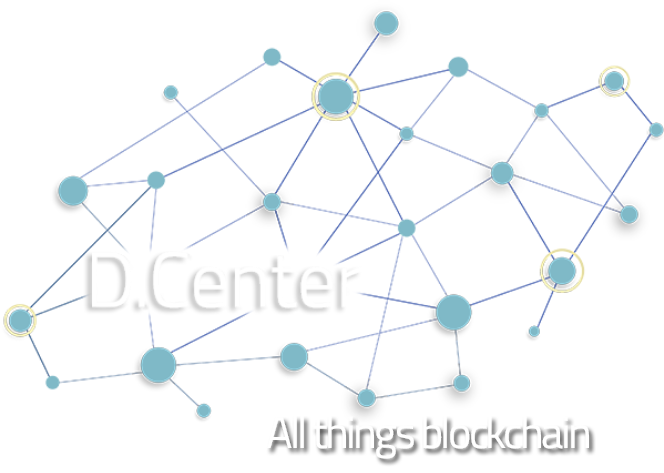
La France est-elle un bon endroit pour l’industrie crypto?

Les histoires de la semaines sont d’abord publiées dans notre Newsletter. Abbonnez-vois ici pour les reçevoir directement dans votre boite email tous les lundis.
TL;DR La France a été présentée comme un pays favorable aux crypto-monnaies ces derniers temps : avec une législation spécifique aux crypto et un ministre de l’économie qui aime parler de soutien à l’industrie de la blockchain, elle a attiré des géants tels que Binance et Crypto.com, qui ont choisi Paris comme leur siège européen et ont apporté des fonds d’investissement totalisant 250 millions d’euros.
La France abrite une demi-douzaine de sociétés crypto de renommée mondiale, et sa scène NFT se développe rapidement.
Cependant, tout n’est pas rose : la plupart des banques françaises refusent toujours de servir les sociétés crypto et les prochaines réglementations MiCA et TRF vont faire peser des charges bureaucratiques encore plus lourdes sur les sociétés, tout en donnant plus d’opportunités aux banques. De plus, la position du gouvernement consiste à pousser les crypto vers les canaux de custody, ce qui est contraire à leur objectif.
Nous avons analysé l’environnement cryptographique actuel – et à venir – en France de différents points de vue : le cadre juridique, l’accès aux services bancaires, l’attitude du gouvernement et l’industrie crypto existante, afin de voir si la France est vraiment un bon endroit pour les entreprises crypto.
Le cadre juridique
La France a été parmi les premiers pays d’Europe à créer un cadre juridique spécifique pour les crypto avec la loi PACTE de 2018, qui :
- a défini les notions de cryptomonnaies et de tokens,
- introduit le statut de prestataire de services d’actifs numériques (PSAN),
- instauré des visas facultatifs de l’Autorité des marchés financiers (AMF),
- mis en place une flat taxe de 30% sur les plus-values en crypto pour les non-professionnels,
- appelé les banques à créer des « règles objectives, non-discriminatoires et proportionnelles » pour le service des PSAN.

À partir de mi-2024, la France sera également impactée par le règlement européen MiCA , approuvé par le Conseil européen le 5 octobre dernier :
- des exigences de réserves plus importantes pour les PSAN ayant plus de 15 millions d’utilisateurs,
- les stablecoins ne peuvent être émises que par des « établissements de crédit » ou des « établissements de monnaie électronique »,
- les stablecoins qui ne « font pas référence à une monnaie officielle » sont placés dans une catégorie spéciale dont la circulation est plafonnée à 200 millions d’euros.
Un accord législatif européen parallèle a également été conclu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent avec le règlement sur les transferts de fonds, qui entrera en vigueur en même temps que le MiCA et qui va:
- obliger les fournisseurs de services crypto à collecter les données de l’expéditeur/bénéficiaire et à vérifier leur exactitude,
- y compris pour les transferts vers/depuis des wallet non-custodials,
- pour tous les transferts dès le premier euro envoyé.
Alors que la loi PACTE a apporté un peu de clarté et de légalité à l’industrie cryptographique française, les réglementations à venir imposeront des charges bureaucratiques supplémentaires aux entreprises crypto et forceront les crypto » légales » dans les canaux de monnaie fiat existants. Cependant, nous pensons que la collecte de données et les obligations de reporting associés à l’AML de fiat sont à la fois inefficaces et dangereux appliquée aux cryptos.
Inefficace parce que la crypto, par nature, n’a pas besoin d’intermédiaires, et les blanchisseurs d’argent qui décident d’utiliser la crypto (mauvaise idée, d’ailleurs) n’utiliseront pas de services de custody.
Dangereux parce que la blockchain est transparente, et qu’en cas de fuite des données reliant une adresse crypto avec un solde important à une personne réelle (ce qui arrive régulièrement à tout stockage de données centralisé), cette personne pourrait être en danger physique.
Bancariser les entreprises crypto
Le secteur bancaire français est très conservateur : depuis des décennies, la majeure partie du pays est desservie par l’un des cinq groupes suivants : BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE ou Crédit Mutuel.
Certaines de ces banques ne veulent toujours pas toucher aux cryptos, d’autres tentent timidement de profiter de l’engouement pour des raisons marketing (comme BNP Paribas avec ses projets de métavers), et la Société Générale est allée jusqu’à obtenir le mois dernier un visa de l’AMF, lui permettant de proposer des services liés aux cryptos.
Elles ont cependant un point commun : aucune de ces banques n’est disposée à servir les entreprises crypto françaises (lire ici sur l’hypocrisie des banques en matière de crypto). De nombreux témoignages confirment leurs refus répétés d’ouverture de comptes ou les fermetures de ceux existants, y compris pour les entreprises disposant d’un visa AMF. Une disposition spéciale de la loi PACTE n’a absolument rien changé à cela.
En 2020, ADAN, l’association française dédiée à la promotion des cryptos, a même mis en place un groupe de travail spécial avec l’ACPR (agence de supervision des banques) et la FBF (Fédération des banques françaises) pour traiter ce problème – pour aboutir en 2021 à une conclusion dont la FBF s’est disassociée.
Jusqu’à présent, aucune indignation publique ne peut faire changer d’attitude les grandes banques françaises. Cela a poussé ses entreprises crypto à chercher des banques de l’autre côté de la frontière (la Bitcoin Avenue de Caen, par exemple, s’est tournée vers une néobanque luxembourgeoise après avoir été débarquée par le Crédit Mutuel), mais cette solution a ses inconvénients pour les clients français de détail, qui peuvent voir leurs virements vers ces banques bloqués.
Cette année, une nouvelle tendance se dessine : quelques petites banques et néobanques, qui menaient auparavant la même politique anti-crypto, commencent à faire volte-face. La néobanque Qonto, qui fermait encore les comptes des sociétés crypto l’année dernière, a récemment signé un accord avec Coinhouse, une société crypto parisienne, pour permettre à ses clients d’acheter et de vendre des crypto. Ensuite, une petite banque familiale, Delubac, a déclaré qu’elle était prête à servir les sociétés crypto.
Nous pensons que cette tendance est une bonne chose à la fois pour les entreprises de crypto françaises et pour son secteur bancaire, qui peut enfin voir une certaine diversification.
Soutien du gouvernement
Le ministre français de l’économie Bruno Le Maire a donné des signaux controversés à l’industrie cryptographique : d’une part, il était prêt à d’accueillir personnellement Binance à Paris (son fond de €100 millions pour l’écosystème français à aidé à pousser les portes), d’autre part, il soutient depuis longtemps le point de vue totalement absurde « Blockchain, pas Bitcoin ».
Lorsqu’il est devenu évident que les « blockchains privées », sur lesquelles reposaient une grande partie des absurdités susmentionnées, étaient effectivement une notion absurde, le discours a changé pour devenir « Crypto, pas Bitcoin ».
Dans une interview donnée le 17 octobre, Bruno Le Maire a annoncé les ambitions de « faire de l’UE une première zone économique mondiale en matière de structuration et d’organisation du marché des crypto-monnaies ». Et au sein de l’UE, la France devrait devenir un « hub européen de l’écosystème crypto ».
Dans le même temps, il a mis en garde contre les dangers de « l’idolâtrie d’un monde sans État, sans banque centrale, sans frontières et, enfin, sans monnaie ». Une telle idolâtrie impliquerait, selon le ministre, de mettre en danger la souveraineté et « les plus fragiles d’entre nous » (il voulait probablement dire les banquiers centraux). Cela confirme une fois de plus sa vision de la « crypto custodial » – un actif enfermé dans des entreprises centralisées qui le contrôlent comme n’importe quelle banque contrôlerait un dépôt en euros. Mais… cela ne défierait-il pas la raison même pour laquelle les cryptoactifs ont été créés ?
Malgré toutes les incohérences intrinsèques des déclarations de M. Le Maires, une déclaration s’est tout de même distinguée de manière positive : « Les cryptomonnaies n’ont pas la même nature que les actions : elles ne représentent pas la propriété d’une entreprise« . Dans un contexte d’incompréhension croissante outre-Atlantique (la SEC américaine n’a toujours pas donné de réponse claire sur les crypto qu’elle considère comme des titres), cette position semble rassurante pour les marchés.
L’industrie crypto française : technologie et créativité
L’Observatoire européen de la blockchain, une initiative parrainée par la Commission européenne, a récemment publié un rapport qui recense plus de 160 « startups blockchain » en France. C’est peu par rapport à la petite Suisse, qui elle compte 877 entreprises crypto, mais il est vrai que plusieurs entreprises éminentes ont effectivement été créées en France : Ledger (fabricant de wallets matériels, licorne), iExec (informatique décentralisée), Acinq (développeur de logiciels sur Lightning Network) et Tezos (blockchain avec des laboratoires de développement en France et la fondation en Suisse).
Le rapport a oublié Sorare (NFT football, licorne) et The Sandbox (société de métavers ouvert basée à Paris et appartenant à la société hongkongaise Animoca Brands) et mentionne des sociétés déjà inexistantes ou très petites, nous ne nous réjouirons donc pas trop de sa pertinence. Cependant, l’échelle semble correcte.
Parmi les entreprises françaises crypto, il n’y a presque aucune entreprise financière ou DeFi en raison de la lourdeur de la bureaucratie et du manque notoire de services bancaires (fondée dès 2011, la société française Paymium a été l’une des premières crypto exchanges au monde, mais elle n’a pas réussi à se développer et est maintenant presque invisible par rapport aux autres).
Cependant, la France dispose de nombreux talents en informatique et en mathématiques, ce qui permet des développements technologiques intéressants.
Une autre compétence pour laquelle les Français sont connus est la créativité, et dans l’espace crypto, la créativité s’exprime souvent par le biais des NFT. Une initiative remarquable appelée NFT Factory a été lancée cette année pour développer la scène NFT française par le biais de conférences (voici notre rapport de la dernière en juillet), de collaborations et, plus récemment, d’un espace physique au centre de Paris.

L’avenir des crypto en France
Les NFT sont notoirement absents des réglementations existantes et à venir, et nous pensons que cela pourrait être bénéfique pour le développement des entreprises connexes. Combiné avec le secteur créatif pour lequel les Français sont célèbres – art, mode et jeux – cela pourrait aider la France (et Paris en particulier) à développer une scène NFT florissante.
En ce qui concerne le secteur financier de l’industrie crypto, nous pensons que seules les entreprises capables de soutenir de grands départements de compliance seront en mesure de réussir en France. Binance et Crypto.com bien sûr, mais aussi les banques françaises existantes, qui pourront prendre de l’avance notamment en matière d’émission de stablecoins.
Enfin, la partie non-custodial de la crypto, comme la DeFi, pourrait avoir du mal à justifier son activité auprès d’un gouvernement de plus en plus intrusif (ces entreprises devraient éviter l’ensemble de l’UE).